- Chronique d'Evariste
- Protection sociale
- ReSPUBLICA
La protection sociale au cœur de la lutte des classes
par Évariste
Pour réagir aux articles,
écrire à evariste@gaucherepublicaine.org
Le système français de Sécurité sociale voit le jour au lendemain de la Seconde guerre mondiale avec la parution des ordonnances Laroque du 4 et du 19 octobre 19451. Meurtrie et dévastée par la guerre, humiliée par l’occupation allemande et par ses propres turpitudes vichystes, la France sut trouver chez une poignée de résistants la force d’ériger de la plus éclatante des manières son propre rétablissement moral. Le programme du Conseil National de la Résistance (CNR), également intitulé « Les Jours Heureux », reste à ce jour un acte d’héroïsme patriotique qui n’a d’égale que l’audace de son contenu tant sur le plan économique que social.
Plan :
Rappel des ambitions du CNR
Ambroise Croizat et Pierre Laroque élaborent donc un plan complet de Sécurité sociale, à savoir un système « visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des assurés et de l’État et une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ».
Tout travailleur exerçant une activité rémunérée donnant lieu à versement de cotisation sociale se voit affilié (ou rattaché) à un régime obligatoire de Sécurité sociale. Originellement Pierre Laroque avait souhaité mettre fin à l’émiettement de la Sécurité sociale entre une pluralité de régimes à base socioprofessionnelle. C’est en ce sens qu’est érigé le Régime général de Sécurité sociale qui, comme son nom l’indique, devait couvrir l’ensemble de la population française sans exclusive.
Malheureusement, cette ambition louable a fait long feu. Finalement, la loi du 22 mai 1946 limite le Régime « général » aux salariés de l’industrie et du commerce. En dépit de cette volte-face originelle, le Régime général constitue à ce jour le pilier central de la Sécurité sociale et génère plus de 70 % des montants financiers versés annuellement par la régimes de base de la Sécurité sociale. En outre, cette dispersion de la Sécurité sociale entre plusieurs régimes ne doit pas nous faire oublier que tous les régimes participent d’une seule et même logique ; celle d’une prise en charge collective et obligatoire des risques sociaux par des institutions du salaire socialisé, dépositaires de la cotisation sociale et garantissant un droit social inaliénable aux travailleurs. La cotisation sociale est donc tout à la fois un mode de financement de la Sécurité sociale et la condition d’ouverture d’un droit à des prestations de Sécurité sociale pour les salariés et leur famille. Mais plus encore, la cotisation sociale est le fondement de l’exercice d’un droit politique nouveau des salariés, s’exprimant au sein des Conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale. Dès lors la Sécurité sociale offre tout à la fois aux travailleurs une assurance inaliénable contre la peur du lendemain mais plus encore les clés d’une expression politique nouvelle : la Démocratie sociale.
L’extraordinaire projet politique du CNR n’est plus cependant que l’ombre de lui-même. En effet, la Sécurité sociale fait l’objet depuis plusieurs décennies d’une remise en cause de grande ampleur. Les dirigeants politiques français, empêtrés dans un modèle européen pétri d’idéologie ordo-libérale et mis sous pression par le système financier international, organisent depuis plus de trente ans une destruction programmée du modèle social hérité du Conseil National de la Résistance au travers d’un triple mouvement « réformateur » passant par la remise en cause de la cotisation sociale, la réduction continue des prestations sociales et la dissolution de la démocratie sociale2.
Un des drames de la période, c’est que même l’Autre gauche n’a plus comme axe prioritaire de lutte la défense et la promotion de la Sécurité sociale.
Or rappelons son poids dans la richesse créée : plus de 31 % du PIB soit largement plus de 600 milliards d’euros (soit près de 10 fois plus que le budget de l’Éducation nationale, premier budget de l’État).
Rappelons aussi que la plus grande partie de cette masse financière est gérée sans accumulation et sans recours aux mécanismes du marché ce qui est un plus pour les salariés et les citoyens avec leurs familles dans cette période de crise. Même si le modèle réformateur néolibéral n’a de cesse de pousser à l’introduction des mécanismes de marché tant à l’intérieur de la Sécurité sociale que dans le reste de la protection sociale en général.
Le mouvement réformateur néo-libéral a engagé un triple mouvement d’étatisation, de privatisation et d’expropriation de la Sécurité sociale
Pour imposer le principe réformateur néo-libéral le Patronat s’est attaché à faire croire que la cotisation sociale serait un prélèvement social et non une partie socialisée du salaire. Pour ce faire, il a fallu imposer la fiction selon laquelle la nature juridique de la cotisation sociale serait duale au lieu d’en faire un bloc homogène de nature salariale : d’un côté la cotisation salariale, payée par le salarié pour ouvrir des droits sociaux, d’un autre côté la cotisation patronale présentée comme un prélèvement social à la charge des employeurs. C’est évidemment une fiction car la cotisation sociale doit être considérée comme une part indivisible et socialisée du salaire des travailleurs.
S’il est indéniable que la cotisation sociale est la condition d’une ouverture des droits à des prestations sociales, ce droit ne saurait s’entendre que de manière collective et non individuelle. Rappelons pour commencer que les droits sociaux sont ouverts dans un cadre familial : c’est le cas pour l’assurance maladie en particulier qui bénéficie à l’assuré social mais également à sa famille à charge. Mais surtout, le Régime Général de la Sécurité sociale créé par le CNR laissait supposer dans sa dénomination même l’idée d’une généralisation de la Sécurité sociale, y compris à des catégories de travailleurs qui ne cotisent pas faute d’emploi salarié.
C’est en cela qu’il faut bien comprendre la potentialité politique de la cotisation sociale en tant qu’elle confère au salariés les armes politiques de leur émancipation sociale au travers des structures du salaire socialisé. Il ne s’agit pas d’une idée déconnectée du réel mais d’un point essentiel qui est le fondement ontologique de la cotisation sociale en tant qu’elle légitime l’exercice d’un droit social inaliénable des salariés à des prestations sociales (et non pas d’un droit dérivé d’une délibération politique extrinsèque du pouvoir étatique potentiellement affidé aux intérêts patronaux) de même que l’exercice d’un droit politique autonome qui est censé s’exprimer dans les structures de la démocratie sociale. C’est cet ensemble que nous appellerons le Droit social (avec un grand D) et qui doit être perçu comme un vecteur d’unification statutaire et politique des salariés (au sens collectif) en permettant de faire passer le travailleur atomisé en membre d’un collectif politique qui dispose des armes de résistance au diktat du marché : droits sociaux régis par des règles d’ordre public (droit du travail et bien sûr prestations de Sécurité sociale), et droits politiques qu’ils devraient exercer souverainement au sein d’institutions représentatives de la démocratie sociale.
Dès lors nous comprenons mieux le sens du projet réformateur néo-libéral : il s’agit casser la dynamique politique de la cotisation sociale en inscrivant la Sécurité sociale dans une logique strictement assurantielle. Ainsi, seuls les salariés inscrits à titre individuel dans un emploi et acquittant des cotisations sociales sur leur salaire seraient habilités à prétendre (à titre individuel) à des prestations de Sécurité sociale et à disposer d’un droit de représentation politique au sein des conseils d’administration de la sécurité sociale. D’autre part, le Patronat, se présentant co-financeur de la Sécurité sociale, a obtenu un renforcement considérable de son pouvoir de gestion au sein des organismes sociaux, ce qui a permis de justifier l’introduction du paritarisme en 1967 alors qu’il était minoritaire jusque-là au sein des Conseils d’Administration3.
Le Patronat poursuit depuis lors une stratégie très habile visant à exercer la mainmise sur les pans assurantiels de la Sécurité sociale et à se débarrasser du financement des domaines qui ne contribuent pas peu ou prou à sa logique capitaliste. Une conséquence essentielle de cette logique, a été de créer une ligne de partage entre prestations sociales dites contributives ou assurantielles (retraite, chômage, prestations en espèces de l’assurance maladie) et les pans dits universels de la Sécurité sociale (allocations familiales, traitement de la pauvreté, prestations en nature de l’assurance maladie).
Pour ces dernières, le financement par la cotisation sociale est remis en cause au profit d’un financement par l’impôt prétextant qu’il serait illégitime de faire reposer le financement de prestations universelles sur les revenus du travail. Le patronat est soutenu sur cet objectif par les syndicats complaisants et par les partis de droite et de gauche du mouvement réformateur néolibéral.
Concrètement, cette stratégie vise à transformer la branche famille de la Sécurité sociale en simple opérateur de redistribution à destination des familles les plus pauvres, à limiter les prestations d’assurance maladie au « gros risque » (soins très coûteux ou à destination d’assurés peu solvables) et à mettre en œuvre un continuum de prestations d’assistance à destination des exclus du monde du marché de l’emploi. Or, cette stratégie s’appuie sur deux ressorts :
Primo, la fiscalisation de la Sécurité sociale, autrement dit, le fait de substituer l’impôt à la cotisation sociale et de faire financer par les assurés eux-mêmes des prestations qui relevaient d’un financement salarial. La Contribution sociale généralisée (CSG), les allègements massifs de cotisations dites patronales, la contre-réforme régressive de la branche famille, et enfin le Pacte de responsabilité s’inscrivent évidemment dans cette logique, de telle sorte que la cotisation sociale ne représente plus guère que 59 % du financement de la Sécurité sociale et sûrement beaucoup moins demain. La fiscalisation de la Sécurité sociale vise à sortir les pans universels du champ du Droit social. Les conséquences sont considérables :
- cela légitime le cantonnement des prestations de Sécurité sociale aux seules situations de lutte contre la pauvreté au travers de prestations placées sous conditions de ressources et sujettes à l’arbitraire des décisions politiques (exemple : le plafonnement des allocations familiales …) ;
- on retire aux salariés leur pouvoir politique au sein des conseils d’administration de la Sécurité sociale. Pour la branche famille qui sera totalement fiscalisée à terme avec le pacte de responsabilité, cela signifie ni plus ni moins, la suppression à terme à terme des conseils d’administration et l’étatisation de la branche, retirant aux salariés le dernier lieu d’exercice de la démocratie sociale ;
- et, plus grave, cette stratégie tend à casser l’idée même d’extension du champ du Droit social et du salaire socialisé à des personnes non immédiatement inscrites dans l’influence économique de l’employeur. C’est enfoncer un coin mortifère dans le projet de généralisation de la sécurité sociale et d’unification statutaire des travailleurs autour d’institutions sociales et politiques communes potentiellement en extension. De la sorte, les réformateurs légitiment l’opposition sociale entre « insiders » et « outisders » du marché du travail et visent à présenter les bénéficiaires de prestations sociales universelles comme des produits de la solidarité nationale.
Secundo, le développement de prestations fiscalisées d’assistance sociale est lié à la mise en œuvre d’une politique agressive « d’activation » des dépenses de solidarité, terme visant à inciter par tous les moyens les pauvres à justifier par une contrepartie en emploi le bénéfice des prestations d’assistance. La mise en œuvre du RSA-activité sous Nicolas Sarkozy participe directement de cette logique visant à contraindre les pauvres à retourner par tous les moyens dans l’emploi même le plus dégradant. Conformément à la doctrine sociale de l’Eglise, les pauvres sont en effet considérés comme responsables de leur situation sociale de par leur goût pour l’oisiveté. Il convient par tous les moyens de les remettre sur les rails de l’activité et si possible sous contrôle social de l’employeur.
Les pans assurantiels de la Sécurité sociale inscrits dans le projet de contrôle social des travailleurs
Les pans dits assurantiels de la Sécurité sociale sont composés des prestations sociales dont le droit est lié à un acte de cotisation préalable. Ces prestations ont par ailleurs pour finalité de couvrir une perte de salaire et sont par nature intimement liés à l’exécution du contrat de travail. Nous y retrouvons en particulier les retraites, le chômage, les accidents du travail, et les indemnités journalières d’assurance maladie.
Dans ces domaines, le patronat souhaite limiter mais non supprimer la cotisation patronale car elle lui donne un extraordinaire levier politique pour instaurer un contrôle social intégral des travailleurs. L’objectif recherché par le patronat est d’assortir ces prestations sociales d’un objectif de soumission des travailleurs aux contraintes économiques de l’entreprise et de les faire participer de gré ou de force aux stratégies de placement financiers du capitalisme transnational.
Le Patronat entend en premier lieu contrôler de manière coercitive les situations d’inactivité des salariés qui nuisent au projet de maximisation des profits de l’entreprise. En second lieu le patronat entend imposer aux salariés leurs propres solutions d’assurance sociale afin d’orienter les salaires dans les stratégies de placement sur les marchés financiers.
Il s’agit tout d’abord de renforcer les contrôles patronaux sur les arrêts de travail ou de soumettre les chômeurs indemnisés à un contrôle étroit en matière de recherche d’emploi, même disqualifié. Mais c’est vraiment dans le domaine des retraites que le projet néo-libéral prend tout son sens : celui-ci entend pousser l’idée d’une retraite à la carte, inciter les travailleurs âgés à cumuler emploi et retraite et surtout obliger les salariés à souscrire des plans de retraites d’entreprise par capitalisation qui renforcent la bulle spéculative mondiale et fait pression à la compression des coûts salariaux (fonds de pension, régimes de prévoyance etc…).
Le fait que le patronat participe au financement des prestations sociales par le biais de la cotisation sociale lui donne évidemment une légitimité politique considérable renforcée de surcroît par sa participation aux régimes de prévoyance d’entreprise qui complètent les prestations de Sécurité sociale. De la sorte les organisations patronales se trouvent dans une position hégémonique, au gré d’alliance de circonstance avec un ou plusieurs syndicats complaisants, au sein régimes complémentaires de retraite obligatoire AGIRC-ARRCO ou d’assurance chômage UNEDIC qui sont devenues les têtes de pont du projet de « refondation sociale » du Patronat initié au début des années 2000. Il s’agit du côté pile de sa minimise politique au sein de la Protection sociale française qui lui a permis d’imposer un durcissement sans précédent des droits sociaux des chômeurs et d’imposer l’idée d’un basculement inéluctable des retraites complémentaires vers un régime notionnel par points.
Le côté face de la domination patronale s’exerce dans le monde de la prévoyance d’entreprise. Le secteur des complémentaires santé d’entreprise et des Instituts de prévoyance (IP) qui vont bénéficier du jackpot de la généralisation des régimes complémentaires d’entreprise à partir de 2016, constituent, rappelons-le, un lieu de domination patronale univoque. Idem pour la branche assurances du patronat (la Fédération Française des sociétés d’assurance FFSA), via les groupes de protection sociale (regroupement de mutuelles, IP et FFSA) et de leurs complices la Mutualité française. Tous ces dispositifs procurent au patronat, si on y ajoute la formation professionnelle, le moyen de soumettre les salariés à un contrôle intégral de leur temps individuel par l’employeur et une acceptation du jeu patronal de placement de leur salaire sur les marchés financiers … avec toutes conséquences que l’on connaît depuis 2008.
Mais il faut bien comprendre que la stratégie néo-libérale n’est pas uniquement économique, elle poursuit en réalité un objectif politique univoque au cœur du rapport de production capitaliste et, disons-le, de la lutte des classes4. Le « mouvement réformateur néolibéral » vise en réalité à stratifier le monde de l’emploi et à le répartir en 3 zones distinctes :
- celle des super-salariés, déconnectée du salaire et dont les rémunérations sont largement liées à des logiques capitalistiques et patrimoniales (actions, plans de retraite et prévoyance d’entreprise, rémunérations variables sur objectifs…). Cette zone est composée des travailleurs collaborant le plus directement au projet capitaliste de l’employeur et dont le patronat entend bien les détourner d’une alliance objective avec les autres travailleurs ;
- celle des salariés précarisés, dont la rémunération repose sur le salaire mais dont les droits sociaux associés sont continuellement rognés et largement placés sous le contrôle social de l’employeur qu’il exerce au sein même des institutions sociales censées protéger les salariés. L’objectif du patronat est de disposer d’un volant d’employés dénués de quelconque garantie collective associée au salaire (affaiblissement du droit du travail et de la Sécurité sociale) et soumis à l’arbitraire des décisions d’embauche, placées dans un cadre contractuel épuré de règles d’ordre public et dont l’atomisation rend impossible toute mobilisation collective syndicale et politique ;
- celle des sous-travailleurs pauvres. Il s’agit du nouveau lumpenprolétariat à qui l’on propose l’alternative suivante : 1) le retour par tous les moyens à l’emploi par le biais de dispositifs d’activation dégradants (RSA activité, emplois aidés…) et largement subventionnés par l’État ; ou 2) la sortie littérale de l’économie de l’emploi marchand pour les plus « irrécupérables » (dans l’esprit du patronat), soumis à des stratégies de survie inscrites dans l’économie parallèle assortie d’un traitement pénal de la misère.
Cette triple stratégie de stratification/atomisation/destruction de salariat doit bien nous amener à comprendre en quoi les principes constitutifs de la sécurité sociale du CNR sont un des fondements de la reconquête du prolétariat et de ses alliés. Sans cela, il ne peut y avoir de transformation d’une classe en soi en classe pour soi ou dit autrement d’une classe objective en classe subjective. Message adressé à l’Autre gauche française qui dénote une des causes du fait qu’elle n’est pas, loin s’en faut, à la hauteur des enjeux5
Face à cela, le mouvement syndical revendicatif et l’Autre gauche ne sont pas à la hauteur des enjeux
Devant cette attaque de grande ampleur, les trois piliers de la transformation sociale et politique ne sont pas à la hauteur des enjeux :
- D’abord le mouvement syndical revendicatif est en recul et de plus a des problèmes internes liés à son incapacité de se démocratiser ce qui pour l’instant, affaiblit son action. Nous reviendrons sur ce point dans une chronique d’Évariste spécifique
- Puis, l’Autre gauche politique a reculé lors des élections de 2014 et ne considère pas la nécessaire campagne politique descendante de défense et de promotion de la protection sociale solidaire comme une priorité. De nombreuses structures locales et départementales n’ont même pas un responsable protection sociale engagé dans des actions.
- Enfin, l’éducation populaire ascendante existe mais n’est pas développée comme elle devrait l’être. Sans éducation populaire, pas de bataille pour l’hégémonie culturelle et donc pas de transformation sociale et politique (Antonio Gramsci).
Pour l’instant, l’intoxication, la désinformation, le matraquage idéologique, donne aux médias dominants la part belle dans la lutte des classes. Pour l’instant, c’est le Medef qui gagne la bataille des mots : la cotisation devient une « charge », le salaire socialisé devient un « salaire différé », etc.
Construire le chemin de l’émancipation qui nous amène à un modèle politique alternatif au capitalisme
D’abord, il faut débattre du modèle politique alternatif6. Et à l’intérieur du modèle alternatif, il faut construire un projet ambitieux de protection sociale solidaire7 pour en débattre.
Car c’est bien à partir des fondements de la Sécurité sociale de 1945, ce « déjà-là » du vrai socialisme futur, dont de nombreux militants de l’Autre gauche n’ont toujours pas conscience d’ailleurs, que l’on peut construire la Sécurité sociale à caractère universel. La cotisation sociale peut porter en soi la dimension d’universalisation du salaire en garantissant à tous les citoyens le bénéfice politique des institutions du droit social qui leur permet de sortir du champ de l’assistance. Il faut continuer et dire qu’il faut augmenter la cotisation sociale mais dans un modèle politique alternatif et sanctuariser l’entièreté de la protection sociale sous le contrôle de la Sécurité sociale refondée, devenue alors une institution du droit social totalement indépendante des mécanismes des marchés et des pratiques d’assistance qui retrouverait alors ses principes de 1945.
Alors, n’hésitez pas à joindre le Réseau Éducation Populaire pour construire vos événements d’éducation populaire dans ce domaine comme dans tant d’autres.
- La Sécurité sociale comporte la branche retraites, l’assurance-maladie, la branche famille, les accidents du travail et les maladies professionnelles et la banque de la Sécurité sociale, l’ACOSS. Son budget est de plus de 30 % supérieur au budget de l’État tous ministères confondus. Si on ajoute l’assurance-chômage, l’AGIRC et l’ARRCO, les complémentaires santé, les politiques sociales et certains petits régimes, on obtient alors la protection sociale. [↩]
- Pour une histoire des remises en cause de la Sécurité sociale, lire les 27 premières pages du livre « Contre les prédateurs de la santé » de Catherine Jousse, Christophe Prudhomme et Bernard Teper, Collection Osez la République sociale chez 2ème édition [↩]
- Il a fallu attendre les ordonnances réactionnaires de 1967 pour remplacer ce mode de gestion par le paritarisme qui donnait ipso facto le pouvoir au patronat avec le concours d’un syndicat complaisant, FO à sa création, remplacé aujourd’hui par la CFDT et certains autres syndicats d’accompagnement du néolibéralisme. [↩]
- Méditer au passage la phrase de Warren Buffet : « La lutte des classes existe. Et c’est notre classe, celle des riches, qui est en passe de la gagner ». [↩]
- Aucune campagne d’éducation populaire n’est programmée depuis longtemps par les partis de l’Autre gauche française ni en politique de temps court (contrairement à la dynamique Syriza) ni en politique de temps moyen et de temps long. [↩]
- Lire à ce sujet, les deux tomes de « Penser la République sociale pour le XXIe siècle » de Pierre Nicolas et Bernard Teper, Collection Penser et Agir, Eric Jamet Éditeur ↩]
- Lire « Pour en finir avec le trou de la Sécu, repenser la protection sociale au 21e siècle, d‘Olivier Nobile en collaboration avec Bernard Teper dans la collection Penser et Agir, Eric Jamet Éditeur ↩]
- Débats laïques
- Société
« Réhabiliter les communautés » : le multiculturalisme contre la laïcité !
par Charles Arambourou
Union des Familles Laïques
http://www.ufal.org
Publié le 5 févier 2015
Jean-Claude Sommaire, ancien secrétaire général du Haut Conseil à l’Intégration, propose ses solutions pour la « prévention de l’islamisme » : il s’agirait de reprendre le « chantier ouvert par Jean-Marc Ayrault » à partir du rapport Tuot « pour une République inclusive » de février 2013. Rappelons que les cinq rapports « sectoriels » qui en sont issus, proposant par exemple la suppression de la loi sur les signes religieux à l’école, avaient été discrètement retirés du site de Matignon devant les protestations des Républicains et des laïques. Les voilà de retour, édulcorés mais frappés au coin du même sociologisme – risquons le mot : sommaire…
La sociologie détournée en « sport de combat » contre la laïcité
L’enseignement du « fait religieux » à l’école avait ouvert la voie : pour toucher à la laïcité sans en avoir l’air, il suffit de remplacer « religion » par « fait religieux ». Un « fait », n’est-ce pas, c’est objectif : il est interdit de l’ignorer, et obligatoire de lui faire sa place, sous peine de « déni de la réalité ». A la base, une idéologie politique sommaire : la République indivisible et la laïcité seraient des « abstractions », la sociologie au contraire nous décrirait la vraie société, qui est pluriculturelle et pétrie de racines religieuses, et détermine l’identité de tout individu.
A cela, les Républicains opposent, depuis les Lumières et la Révolution, un discours cohérent : le citoyen, fondement de la République, est une construction politique partant d’une conscience émancipée, qui dépasse donc l’ensemble de ses particularismes « sociologiques » (communautaires, ethniques, religieux, etc.) La société est pluriculturelle, la République indivisible. Les individus sont croyants, incroyants, athées, indifférents… ; la République ne connaît que des citoyens.
J.-C. Sommaire, pratique la novlangue du sociologisme. Il ne dit pas « multiculturalisme », mais « réalité pluriculturelle » ; ni « communautarisme », mais « fait communautaire ». Les concepts restent les mêmes, et il nous propose rien moins que de nous y adapter, au nom de la fameuse « laïcité d’inclusion », grâce à des « accommodements raisonnables » (dont l’exemple canadien a prouvé qu’ils amplifiaient en réalité communautarisme, ségrégation, et intégrisme !).
Pour lui, le « réalisme » sociologiste commanderait de modifier nos lois, d’ailleurs « perçues comme punitives à leur égard par beaucoup de musulmans » – donc d’autoriser le port de la burqa dans la rue et celui des signes religieux par les élèves des écoles publiques (ce sont ses deux exemples). En un mot, d’en finir avec la laïcité ! Dans ces conditions, la brillante formule « réhabiliter le fait communautaire pour faire obstacle au communautarisme » n’est plus qu’un paralogisme : pour sauver la République, faut-il réhabiliter ce qui la tue ?
Les « issus de… », version politiquement correcte des « races »
Mais la sociologie utilisée mérite également qu’on s’y arrête. J.-C. Sommaire s’est déjà illustré (Rue89, 11/01/2013) par un article soulignant la « surdélinquance des jeunes issus de l’immigration d’origine maghrébine et africaine sub-saharienne », qui avait fait polémique. Aujourd’hui, il reprend exactement les mêmes termes (et en gros les mêmes solutions). En revanche, il nous précise que « beaucoup de jeunes issus des immigrations extra-coloniales portugaises, turques, tamoules, indo-pakistanaises, chinoises (…) semblent s’insérer plus facilement ». Du coup, sa clé de lecture de l’immigration « post-coloniale »/« extra-coloniale » ne marche pas -à moins d’ignorer quelle colonisation ont subi les « indo-pakistanais » !
Pire, Sommaire oppose tous ces « issus de… » à « la majorité autochtone » : l’essentialisation ethnico-nationale suscite plus qu’un malaise. Le discours multiculturaliste risque fort de déraper vers un « différentialisme » (« chacun chez soi, chacun ses lois –mais pas chez moi ») aux résonances sinistres. J. C. Sommaire se réclame certes de convictions humanistes, mais il chausse de vielles lunettes déformantes. L’idéologie ne saurait tenir lieu de méthodologie. Soit sa formulation : « les jeunes générations issues de la diversité » ; d’où « sortent » les malheureux ainsi désignés (stigmatisés) ? La « diversité » n’est qu’un euphémisme grossier de la langue de bois multiculturaliste pour désigner « ceux qui ne sont pas blancs ». Synonyme : « les minorités visibles », essentialisation de groupes humains imaginaires, car triés en fonction de leur couleur de peau. Bref, un racisme chic qui va jusqu’à demander des « statistiques ethniques » (comme le faisaient –tiens !- les épigones de Tuot précités…).
Si les frères Kouachi et Coulibaly ont assassiné, ne cherchez pas : c’est à cause des discriminations infligées par la France à « nos jeunes compatriotes issus de l’immigration post coloniale ». Or ils étaient Français, nés en France et non « blédards », commandités et financés par des réseaux politiques internationaux, deux d’entre eux ayant été entraînés au Yémen : ni l’immigration, ni le « post colonialisme » ne sont donc facteurs explicatifs. Ni la misère. Citons Boualem Sansal, écrivain algérien (journal Le Progrès, 29/01/2015) :
« Je ne crois pas aux explications de ceux qui mettent en avant la misère sociale, comme terreau premier du djihadisme. Il existe un projet politique dans le monde pour propager l’islamisme et porter le djihad d’abord en terre musulmane, puis ailleurs, en terre chrétienne notamment. »
Quant aux « discriminations », façon subtile et instruite de taire les « inégalités sociales », il suffit de rappeler que les « minorités visibles » n’en ont pas le monopole. Rappelons leurs principales victimes : les femmes, les homosexuels, les handicapés, les jeunes avant 25 ans, les personnes âgées, les salariés de plus de 50 ans, etc. La liste en est inépuisable ; les « minorités » additionnées représenteraient 90% de la population ! Pour toutes ces discriminations, l’origine étrangère non communautaire (réelle ou supposée), la couleur de peau, ou le lieu de résidence n’est qu’un facteur aggravant, et pas à sens unique : témoins les sur-discriminations infligées aux femmes et aux filles des quartiers communautarisés (tenue, sexualité, maternité, retrait des études ou du travail…) par leurs propres communautés.
Non, il n’y a pas un « bon usage des communautés »
A son tour, J.-C. Sommaire découvre « la réalité pluriculturelle de la société française » – sait-il que cela dure depuis la préhistoire ? D’où les trois « chantiers » qu’il propose.
1) Aborder le « fait communautaire » « en le distinguant du communautarisme », pour mieux le faire évoluer et « faciliter l’intégration » : pur verbalisme, car c’est exactement le contraire qui se produit sur le terrain. Toute concession au communautarisme fait le lit des extrémistes, et enferme définitivement dans la communauté celles et ceux qui veulent en sortir ! Il faut lire le témoignage de Pierre Bouchacourt, ancien élu municipal (PS) : Quand le communautarisme municipal se heurte au fondamentalisme religieux (Huffington Post 01/02/2015) :
« J’ai vu (…) les croyants sincères heureux de pouvoir prier dans leur nouvelle mosquée [subventionnée par la commune, NDLA] se faire doubler par des fondamentalistes, les tracts distribués dans la « mosquée pour un islam de la tolérance » qui appelaient au djihad. »
2) « Revisiter la question religieuse à la lumière d’une laïcité d’inclusion » (sic). Autrement dit, bricoler le principe de neutralité religieuse pour voir s’il n’est pas possible « dans les collectivités locales, les établissements scolaires, les centres sociaux et médico-sociaux » d’autoriser les repas halal, le port du voile, l’ouverture de salles de prières. Le tout « en fonction des caractéristiques de leur environnement » : communautarisme à Bobigny, laïcité à Neuilly ?
3) Développer les actions éducatives et sociales selon les « problématiques interculturelles » et les « méthodes de développement social communautaire ». On voit mal comment « des actions éducatives (…) à vocation émancipatrice » pourraient être menées en assignant les individus à leur communauté ! Cerise sur le gâteau : « une approche laïque des questions religieuses » est recommandée : on croyait naïvement que la laïcité consistait précisément pour les pouvoirs publics à NE PAS s’occuper des « questions religieuses » et à enseigner aux enfants à les laisser de côté à l’école publique…
A partir d’une analyse dangereuse, Sommaire propose des solutions qui ne le sont pas moins – la pratique l’a montré. On ne combat pas l’extrémisme communautarisé en « réhabilitant les communautés ».
- Débats laïques
- Ecole publique
Laïcité et École : interview de Catherine Kintzler
par Catherine Kintzler
http://www.mezetulle.net
Vous êtes spécialisée en philosophie de l’art. Comment en êtes-vous arrivée à la question de la laïcité ?
La philosophie de l’art a été présente, avec Rameau, dès que j’ai commencé à publier alors que j’étais professeur de philosophie dans le secondaire (où j’ai exercé pendant 22 ans). Elle est devenue spécialisation professionnelle lorsque j’ai soutenu ma thèse d’État en 1990 et par la suite lorsque j’ai enseigné dans le supérieur.
J’ai commencé à travailler sur des questions liées à l’actualité, de façon militante et totalement disjointe de mon enseignement, durant les années 1980, d’abord sur la question de l’école, puis sur la laïcité. Et à chaque fois, le déclencheur fut une indignation.
Sur l’école d’abord. J’étais atterrée par la politique scolaire lancée au début des années 1980 et dont on voit aujourd’hui le succès ; elle a inspiré la plupart des réformes ultérieures. Cette politique consiste à renvoyer l’école à son extérieur, à la transformer en « lieu de vie », à l’aligner sur les demandes sociales et à négliger que son objet est l’émancipation des esprits par l’instruction. Loin de réduire les inégalités culturelles et sociales, on s’appuie sur elles pour élever les « différences » en dogme, on sacralise la proximité à laquelle il conviendrait au contraire de soustraire les élèves quel que soit leur milieu d’origine, on refuse la notion de sanction et l’exigence faite à chaque élève d’atteindre le plus haut niveau dont il ou elle est susceptible. Tout cela fut mis en place dès 1982. Et cette sempiternelle réforme a parfaitement réussi à disqualifier l’idée même d’École républicaine (déjà bien imparfaite auparavant) dont les réformateurs feignent de se réclamer.
C’est à ce moment-là (1984) que Jean-Claude Milner a publié son livre De l’école, réédité en 2007, il n’a pas pris une ride aujourd’hui.
Étant dix-huitiémiste, j’ai cultivé mon indignation en allant lire les grands textes de la Révolution française sur l’instruction publique. C’est ainsi que j’ai étudié Condorcet et que j’ai publié (1984) Condorcet, l’instruction publique et la naissance du citoyen.
La laïcité ensuite. Elle était déjà présente dans l’étude de Condorcet mais il y eut là aussi un événement déclencheur.
J’étais sur le point d’achever mes travaux de doctorat lorsque, à l’automne 1989, éclate l’affaire dite « de Creil » sur le port du voile islamique dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire publics. Il aurait suffi, me semble-t-il, d’un peu de fermeté et de volonté politique de la part du ministre alors en exercice : réactiver les circulaires Jean Zay. Mais Lionel Jospin ne l’a pas entendu ainsi. En fait, je ne devrais pas dire qu’il a manqué de volonté politique car c’est bien une politique que de fermer les yeux sur le port de signes religieux à l’école publique par les élèves. Très vite, avec Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay, nous avons écrit la « Lettre ouverte à Lionel Jospin », publiée dans Le Nouvel Observateur en novembre 1989. J’ai soutenu ma thèse sur l’opéra dans cette ambiance survoltée. Et j’ai ruminé la question de la laïcité, non pas de manière massive comme je l’avais fait avec celle de l’école, mais point par point, en publiant des articles qui m’étaient en quelque sorte « commandés » par les sujets d’actualité qui, à chaque fois, posaient un problème dont l’élucidation permettait de dissiper une ambiguïté et de mieux cerner le concept (la laïcité scolaire, l’affaire « du gîte d’Epinal », le financement des cultes, le port de la cagoule, les cimetières, etc.). Après avoir publié le bref essai « académique » Qu’est-ce que la laïcité ? (Vrin), en 2007, j’ai tenté une synthèse de cette démarche théorique et pratique dans Penser la laïcité (Minerve, 2014).
Selon vous, en quoi la laïcité va-t-elle au-delà de la tolérance ?
Il faut s’entendre sur le terme « tolérance » qui peut en français désigner une attitude, une disposition. Lorsqu’on met en parallèle laïcité et tolérance, on parle de régimes d’association politique. Le régime de tolérance, théorisé par Locke, est antérieur au régime de laïcité qui a été pensé par un courant de la Révolution française (alors même que le mot « laïcité » n’existait pas encore).
On peut dire que la laïcité va au-delà de la tolérance parce qu’elle place le fondement de l’association politique en deçà du point où le place la tolérance.
Voyons d’abord cet « en deçà ». Mon collègue Philip Pettit, à l’issue d’une conférence qu’il m’avait invitée à faire à Princeton, a employé une comparaison avec un système de numération que je trouve très juste : « Nous les Anglo-Saxons, nous commençons par 1, les Français commencent par zéro »
Le régime de la tolérance s’interroge à partir de l’existant : il y a différentes religions, différentes communautés et il faut les faire exister ensemble. Cette coexistence s’appuie sur l’idée selon laquelle tous croient à quelque chose, ou du moins à des valeurs, et que le lien politique doit se construire sur ce moment de foi initiale. C’est le « 1 » – exprimé notamment par la devise « In God We Trust » inscrite sur chaque dollar. C’est une manière de penser la forme du lien politique en le modélisant sur un lien de type « croyance », un lien fiduciaire.
Le régime de la laïcité considère que toutes les croyances, incroyances et positions s’inscrivent dans un espace qui rend possible leur libre coexistence et que, pour construire cet espace, il faut supposer que le lien politique est étranger à tout autre lien, qu’il n’a pas besoin d’un modèle préalable de type religieux : c’est le « zéro ». On ne cherche pas ce que les différentes positions ont en commun, on cherche un espace qui conditionne a priori la coexistence de toutes les positions, y compris celles qui n’existent pas.
Donc le régime de laïcité est un minimalisme – la puissance publique s’aveugle à tout ce qui est de l’ordre de la croyance et de l’incroyance, elle manifeste cet aveuglement par sa propre abstention en la matière – et ce minimalisme lui permet d’accueillir de manière totalement indifférente un nombre indéfini de positions.
Nous voyons donc que ce fondement, en deçà du régime de tolérance, produit un au-delà dans la multiplicité indéfinie des positions qui jouissent de la même liberté. En termes plus usuels, la tolérance est plus volontiers tournée vers la liberté religieuse que vers la liberté de conscience. Elle n’assure pas toujours de manière certaine la liberté de conscience – laquelle comprend la liberté d’avoir un culte quelconque, mais aussi celle de n’en avoir aucun et de le manifester. Cela ne veut pas dire que les non-croyants sont persécutés ni même rejetés en régime de tolérance, mais ils sont moralement dépréciés par la norme sociale qui veut que chacun ait une religion, et qui va même jusqu’à introduire la notion de croyance dans les serments. En revanche a laïcité assure d’abord la liberté de conscience et fait de la liberté des cultes un cas particulier de la liberté de conscience.
La question philosophique fondamentale est donc celle de la disjonction entre la forme du lien politique et la forme religieuse du lien. Un régime de tolérance part de l’idée selon laquelle la forme de tout lien obéit non pas à une religion, mais à un modèle religieux : c’est avec cette idée que la laïcité rompt.
Maintenant, il y a aussi une différence politique entre les deux régimes, c’est celle de l’accès des communautés en tant que telles à l’autorité politique, celle de la promotion des communautés en tant que telles au statut d’agent politique. Le régime de laïcité accorde des droits étendus à toutes les communautés, pourvu que cela ne contrarie pas le droit commun. Mais ces droits sont civils : aucune communauté en tant que telle ne peut se voir reconnaître un statut politique. La souveraineté réside dans les citoyens et leurs représentants élus, et les droits sont les mêmes pour tous, individuellement : le droit de l’individu a toujours priorité sur le droit collectif. Il est impensable d’imaginer un droit flexible selon la communauté à laquelle on est réputé appartenir, ce qui est possible dans nombre de régimes de tolérance. Du reste en République laïque, il n’y a pas d’obligation ni même supposition d’appartenance.
De plus en plus de Français souhaiteraient bannir les signes religieux de l’espace public. Mais n’est-ce pas déjà le cas ? De quel « espace public » parle-t-on ?
Bien sûr que c’est déjà le cas ! Les signes religieux sont prohibés dans le domaine qui participe de l’autorité publique, qu’il s’agisse d’espaces ou de choses (par exemple les bâtiments officiels : mairies, écoles publiques, préfectures, monuments officiels comme les monuments aux morts…), de personnes durant un certain temps (fonctionnaires et magistrats pendant l’exercice de leurs fonctions) ou d’actes et de discours (lois et règlements, financements publics, propos tenus par un magistrat, un professeur, un ministre dans le cadre de ses fonctions…).
Le terme « public » est l’objet d’un malentendu. Pour tenter de l’élucider, je pense qu’il est utile de rappeler la distinction entre le principe et le régime de laïcité. Le principe de laïcité, que tout le monde connaît, veut que la puissance publique s’abstienne de toute manifestation relative à une croyance ou à une incroyance : ce sont les exemples que j’ai donnés ci-dessus.
Mais cette abstention n’a de sens que parce que son domaine d’application est restreint : cela libère tout ce qui ne participe pas de la puissance publique. Partout ailleurs, dans la société civile (rue, métro, magasins, etc., donc des « lieux publics »), s’applique le principe de libre expression, de libre affichage. Et c’est précisément parce que la puissance publique observe la réserve en son sein que la société civile est d’autant plus libre car aucune option n’est cautionnée ni dépréciée par la puissance publique.
Ainsi le régime de laïcité articule deux principes, le principe de laïcité et le principe de libre expression (dans le cadre du droit commun bien sûr). L’espace juridique en régime laïque n’est donc pas uniforme : c’est le contraire d’un intégrisme.
Donc réclamer le bannissement des signes religieux de l’« espace public » est ambigu.
On peut vouloir dire par là qu’il faut appliquer le principe de laïcité à ce qui participe de l’autorité publique : et là effectivement il faut refuser une croix, un croissant étoilé, une étoile de David, une crèche, etc., dans le hall d’une mairie, car ce serait ouvrir la porte à toutes sortes de revendications particulières d’affichage et encourager chez les élus une attitude clientéliste. Il y aurait des mairies « plutôt catholiques » d’autres « plutôt musulmanes » selon la « clientèle » : elles cesseraient d’être la maison commune.
Mais on peut vouloir dire par là qu’il faut « nettoyer » de tout signe religieux les lieux accessibles au public (la rue, les magasins, les halls de gare, le métro, etc.) : on voit bien à quelles aberrations cela mènerait, à commencer par raser cathédrales et calvaires, anonymer les temples maçonniques, débaptiser les communes dont le nom comprend « Saint », etc. Et si on interdisait le port du voile islamique dans la rue, il faudrait aussi y interdire le port de tee-shirts anarchistes ou athées, interdire les signes maçonniques au revers des vestes… Ceux qui réclament un tel « nettoyage » réclament bel et bien l’abolition de la liberté d’expression – en fait ils ne la réclament que pour une religion seulement !
Beaucoup de confusion règne à ce sujet. Je me rappelle un intervenant lors d’un débat, qui me disait « mais si on refuse une crèche dans une mairie, alors c’est pareil pour un musée national ou municipal et il faut en enlever tous les tableaux et toutes les sculptures à sujet religieux !». C’est confondre l’objet du musée (exposition d’œuvres dans un cadre neutre et critique) et ce cadre lui-même qui n’est pas religieux, car administré par la puissance publique.
L’École publique est le lieu par excellence de la laïcité. Quel est le statut de l’élève en son sein ?
À l’école publique, on comprend bien que l’abstention en matière de religion et d’opinions doit s’appliquer aux personnels, mais pourquoi et dans quelle mesure s’applique-t-elle aussi aux élèves ? Autrement dit : les élèves sont-ils des usagers ?
À la suite du remarquable travail de la Commission Stasi, la loi de 2004 interdit en effet aux élèves d’arborer des signes religieux ostensibles : on leur demande, durant le temps scolaire, une réserve plus grande que lorsqu’ils sont dans l’espace civil ordinaire.
Cela ne les met pas exactement sur le même plan que les personnels, mais cela signifie que l’école, vue du côté des élèves, n’est pas un lieu ordinaire assimilable à une portion de la société civile où peuvent s’afficher les opinions en tant que telles.
L’école publique primaire et secondaire est soustraite à l’espace civil ordinaire parce qu’elle fait partie des dispositifs constitutifs de la liberté, parce qu’elle accueille des libertés en voie de constitution. Il ne s’agit ni de la rue, ni d’un simple « service » au sens ordinaire du mot. On ne vient pas à l’école pour « consommer » un service, on n’y vient pas pour obtenir un papier ou remplir un formulaire : on y vient pour construire sa propre liberté. Et pour cela on a besoin d’un espace critique commun, d’un moment de détour, de retrait et de doute. Voilà pourquoi les élèves ne sont pas des usagers.
Ce n’est pas en faisant défiler les différentes positions devant les élèves qu’on arrive à construire quoi que ce soit, ni en leur disant « il y a différentes communautés et chaque communauté fait ce qu’elle veut, c’est toujours respectable ». Parce qu’alors, chacun reste campé sur son appartenance – à supposer qu’il en ait une. Il faut passer par la nécessité de la crise, une sorte de mise à distance. Une mise à distance de ce que l’on croit penser, de ce que l’on croit être ; c’est nécessaire pour tout le monde, aussi bien pour l’enfant du médecin ou du cadre que pour celui de l’ouvrier ou du paysan, celui du chômeur. Un moment où on fait un pas au-delà de la simple tolérance, en dehors de son appartenance, un moment où le doute est non seulement permis, mais requis. Et cela passe aussi par un acte visible, une sorte de rite qui rappelle concrètement cette nécessité : en passant le seuil de l’école, on devient un peu un autre, un enfant devient un élève, il vit une double vie. Cela ne signifie pas qu’on doit rompre avec son appartenance, avec sa communauté, mais qu’il y a un moment où on n’a affaire qu’à sa propre pensée.
De plus n’oublions pas que l’école publique primaire et secondaire accueille des mineurs de tous horizons, y compris des élèves dont les parents sont incroyants : pourquoi devraient-ils subir un affichage que leurs parents n’approuvent pas nécessairement ? Permettre cet affichage à l’école en prétextant qu’on l’étend libéralement à toutes les religions, c’est normaliser le fait religieux et inviter chacun à s’y inscrire, c’est insinuer que la normalité est d’avoir une religion, c’est déjà avoir pris une option sur la conscience d’élèves mineurs et avoir restreint leur liberté à venir.
À votre avis, la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école a-t-elle été efficace ? Pourquoi était-elle nécessaire ?
Il suffit de lire les attendus du rapport de la commission Stasi, de consulter les auditions auxquelles elle a procédé, de lire le rapport Obin (qui a longtemps été l’objet d’une diffusion pour le moins « confidentielle ») pour comprendre que la loi était nécessaire. Il faut noter que l’expression « loi sur le voile », qu’on entend souvent, est inappropriée : la loi est générale. Il y avait d’ailleurs beaucoup d’affaires de kippa. Mais ce recours à la loi est aussi le résultat de nombreuses années de tergiversation, d’atermoiements au niveau de l’État, de sorte que le recours à une simple circulaire (qui était pensable et qui aurait pu être efficace dès l’apparition des problèmes d’affichage et de revendication religieux à l’école), était devenu dérisoire.
On ne souligne pas assez combien cette loi a une valeur éducative. Car elle « met en scène » de façon concrète et quasi-rituelle la distinction des espaces : l’élève sait qu’il doit quitter un affichage religieux ostensible en entrant dans l’établissement scolaire public, mais il sait aussi qu’il peut le remettre en en sortant. Cela lui fait vivre l’inverse de ce que lui ferait vivre un intégrisme qui demande l’uniformité totale. Donc ceux qui prétendent que la loi de 2004 « uniformise » ne font que montrer soit la confusion de leurs idées soit leur détestation de la législation républicaine. Manifester la distinction des espaces juridiques et la signification profondément libératrice de cette distinction : voilà, à mon sens, l’efficacité principale, du point de vue de l’école et de ses finalités, de cette disposition.
La Charte de la laïcité lancée par Vincent Peillon contribue à cette efficacité. L’idée de réunir dans un même document succinct des éléments dispersés dans la législation me semble excellente, cela éclaircit les idées et ramène à l’essentiel. Mais si l’école, par ailleurs, renonce à sa mission principale qui est d’instruire en mettant en place un espace critique commun, si elle est sommée d’abandonner toute discipline raisonnée, la meilleure Charte du monde sera perçue comme un prêchi-prêcha bienpensant devant lequel une simple génuflexion de façade suffit, et la loi de 2004 sera une coquille vide dont on ne verra que l’aspect formel.
Comment analysez-vous les récents propos de Najat Vallaud-Belkacem concernant les accompagnateurs de sorties scolaires ?
J’ai l’impression d’avoir déjà vu le film ! La ministre reproduit une attitude analogue à celle qu’a adoptée Lionel Jospin en 1989 : on peut interdire, mais il vaut mieux ne pas le faire. Si elle pense vraiment qu’il faut accepter les signes religieux des accompagnateurs, que n’abroge-t-elle la circulaire Chatel ? Cette circulaire n’est pas illégale et jusqu’à plus ample informé elle reste en vigueur. Pour justifier ses atermoiements, la ministre prétend s’appuyer sur une étude du Conseil d’État que ses conseillers juridiques semblent ne pas avoir lue de bien près, car cette étude expose clairement pour quels motifs on peut refuser le port de signes religieux par les accompagnateurs scolaires. La question n’est pas celle du statut de ces personnes, mais celle de la nature de l’activité : la sortie scolaire est une activité scolaire, et l’école reste toujours l’école y compris lorsqu’elle sort de son enceinte habituelle. Mais on reste dans le flou, la responsabilité retombe sur les enseignants. C’est hélas coutumier à l’Éducation nationale : les professeurs ont l’habitude d’être « lâchés » par la hiérarchie, y compris à son niveau le plus élevé.
L’enjeu n’a pas changé. La tendance la plus rétrograde de l’islam entend banaliser le port du voile et l’introduire particulièrement à l’2cole publique. Comme pendant les années qui ont précédé la loi de 2004, elle trouve une forme de complaisance en haut lieu au prétexte de ne pas « stigmatiser ». Ainsi s’accentue, plus généralement, la pression sur les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile.
L’emploi du terme « mamans » est révélateur. Cela suggère une importation de l’intime au sein de l’école. L’école est-elle destinée à prolonger l’intimité du cocon maternel ? N’est-elle pas, par définition, destinée à en faire sortir l’enfant qui, de « gamin », devient alors un élève ? En devenant élèves et en fréquentant l’école les enfants accèdent au luxe d’une double vie. Et les mères d’élèves qui accomplissent cette démarche effectuent un pas remarquable vers l’extérieur du monde des « mamans » duquel on peut imaginer qu’elles souhaitent sortir, au moins temporairement.
Rappelons une évidence. L’accompagnateur scolaire accompagne, par définition, les enfants d’autrui que sont les élèves et cela sans exception, y compris lorsque ses propres enfants sont au nombre des accompagnés. L’accompagnateur n’a donc pas à traiter les élèves comme s’ils étaient ses propres enfants. Réciproquement, il doit traiter ses propres enfants, dans ce cadre scolaire, comme s’ils étaient ceux d’autrui.
Au lieu de cela, on se complaît dans le compassionnel à des fins idéologiques : il y aurait humiliation, stigmatisation. On aura reconnu le thème condescendant, plein d’onction et de violence, de l’intouchable. Car croire qu’une femme, parce qu’elle est voilée, serait incapable de comprendre qu’il existe des espaces et des situations distincts, relevant de réglementations différentes, c’est la mépriser. La demande qui lui est faite de s’abstenir d’affichage religieux dans ce cadre de responsabilité scolaire, loin de l’humilier, la met à la même hauteur que le professeur dont elle partage momentanément la tâche ; loin d’être un impératif blessant et réducteur, elle est un honneur et une marque de considération. Au niveau de la symbolique, c’est peut-être l’inverse qu’il faudrait faire : en même temps qu’on demande à une personne d’ôter momentanément les signes religieux ostensibles dont elle est porteuse, lui remettre un insigne d’accompagnateur scolaire qu’elle pourrait arborer fièrement durant la sortie.
En savoir plus sur Catherine Kintzler :
Vice-présidente de la Société française de philosophie, Visiting Fellow à l’université de Princeton en 2008, elle travaille en collaboration avec des artistes pour des lectures poétiques, la mise au point de publications ainsi qu’à titre de conseiller dramaturgique et d’auteur dramatique. Elle intervient sous forme de conférences et de séminaires dans des maisons de théâtre et d’opéra et auprès de compagnies de spectacles. Dans le domaine politique et de la philosophie politique, en dehors d’interventions devant des sociétés savantes ou dans des séminaires et des colloques de recherche spécialisés, elle donne de nombreuses conférences d’intérêt général.
Page web : http://www.mezetulle.fr
Elle a signé :
– Penser la laïcité, Paris : Minerve, 2014.
– Jean-Philippe Rameau, splendeur et naufrage de l’esthétique du plaisir à l’âge classique, Paris : Minerve, 2011, 3e édition revue et augmentée, (1re éd. 1983 prix Charles Cros) ;
– Qu’est-ce que la laïcité ? Paris : Vrin, 2007, 2e éd. 2008 ;
– Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau, 2e édition revue Paris : Minerve, 2006 (1re éd. 1991, prix Jamati) ;
– Théâtre et opéra à l’âge classique, une familière étrangeté, Paris : Fayard, 2004 ;
– La France classique et l’opéra, (livret avec deux CD audio), Arles : Harmonia Mundi, collection « Passerelles », 1998 ;
– Condorcet, l’instruction publique et la naissance du citoyen, Paris : Folio-Essais, 1987 (1re éd. Le Sycomore, 1984);
Elle est l’auteur d’une pièce de théâtre musicale Du corps sonore au signe passionné, entretien entre Jean-Jacques Rousseau et d’Alembert, représentée pendant l’année Rousseau (2012).
Elle a publié, présenté et annoté l’Essai sur l’origine des langues de Jean-Jacques Rousseau (GF-Flammarion, 1993).
- Ecole publique
- Laïcité et féminisme
Et si les hommes retournaient à l’école
par Storti Martine
http://www.martine-storti.fr
S’agissant de l’école de la République, il est beaucoup question, ces dernières semaines, à coup de métaphores guerrières un tantinet inquiétantes, de « professeurs sur le front », ou « en première ligne », surtout quand ils travaillent dans des établissements scolaires qualifiés de « sensibles » ou de « difficiles ». Ce qui n’est guère souligné, c’est que sur le dit « front », si « front » il y a, ce sont majoritairement des femmes qui y sont.
Les chiffres l’indiquent clairement : les femmes représentent plus de 70 % des personnels de l’Education nationale (82 % pour l’école maternelle et élémentaire, 60 % des professeurs du second degré, 71 % des personnels d’éducation, 90 % des médecins scolaires, quasi-totalité des personnels administratifs et sociaux…) Il n’y a que dans les échelons élevés de la hiérarchie que cette proportion s’inverse : par exemple l’inspection générale comprend à peine 30 % de femmes, et ce n’est pas, on en conviendra par manque de vivier ! Quand est relevé que ce sont plutôt les enseignants débutants qui sont nommés dans les établissements difficiles, ce qui est en effet hors de tout bon sens (mais les plus anciens rechignent à y aller ou à y rester), il faut préciser qu’il s’agit souvent de jeunes femmes.
Les raisons de cette féminisation sont bien connues : « conciliation vie familiale et professionnelle » dont en effet les femmes se soucient plus que les hommes, salaires relativement peu élevés, perte de prestige du métier….
La gente masculine a sinon déserté du moins s’est éloigné de l’institution scolaire, chaque décennie un peu plus et c’est regrettable. Il faut développer la mixité des personnels scolaires. L’enjeu n’est pas dans l’incarnation d’une figure autoritaire que les hommes sauraient mieux assumer que les femmes. Non, l’enjeu est d’affirmer une mixité de la prise en charge institutionnelle de l’éducation, montrer que celle-ci n’est pas, ne doit pas être le seul domaine et la seule responsabilité des femmes, surtout quand tel est déjà le cas dans nombre de familles, et pas seulement les familles monoparentales (rappelons que cette appellation neutre désigne une réalité qui ne l’est pas, puisque dans la plupart des cas le parent en charge des enfants est la mère.)
On souligne abondamment les difficultés rencontrées dans certaines classes pour enseigner tel ou tel auteur ou telle ou telle période historique, au nom d’un interdit religieux ou s’affirmant tel, en l’occurrence islamique. A été ressorti des tiroirs le rapport dit Obin de l’inspection générale, et sont particulièrement cités les passages relatifs à ces difficultés.
Mais bizarrement il est fait silence sur un autre aspect important de ce rapport (et d’autres études, livres, actions, faits divers ont suivi qui allaient dans le même sens) à savoir la situation vécue par des filles dans certains collèges, lycées et quartiers, dans un mélange d’injonctions religieuses, identitaires et virilistes : surveillance par les grands frères, quasi interdits vestimentaires parce que trop sexués comme la jupe ou le jean serré, mixité dénoncée dans des lieux forcément mixtes comme les cinémas ou les centres sociaux, affirmation des inégalités de sexe, confusion entre masculinité et machisme…
Face à des adolescents dont certains sont élevés dans une religion qui prône encore la séparation des sexes dans bien des domaines et qui ne considère pas l’égalité entre les filles et les garçons comme une priorité de son message, il est indispensable d’augmenter la mixité des personnels présents dans les établissements scolaires, quelle que soit la fonction exercée.
Il est tout aussi indispensable de développer l’éducation à l’égalité, qui passe par la mise en cause des stéréotypes, par l’affirmation de la pluralité des figures du masculin et du féminin, des manières d’être fille et garçon, femme et homme. Or il faut se souvenir de la bronca qui a eu raison des ABCD de l’égalité mis en œuvre au cours de la dernière année scolaire, bronca qui a vu se nouer une alliance entre des personnes et des groupes se revendiquant les uns de la religion musulmane, d’autres du catholicisme, d’autres de l’extrême droite et de la droite, tandis que des intellectuels médiatiques tels Alain Finkielkraut ou Michel Onfray expliquaient l’un que ces ABCD visaient à « remodeler l’humanité », l’autre qu’ils empêchaient d’apprendre à « lire, à écrire et à penser ». Rien que ça.
Les assassinats de début janvier ont suscité un rappel de la nécessaire laïcité et des valeurs républicaines. La mixité, l’égalité filles-garçons en sont des composantes essentielles. Il est urgent de les réaffirmer au sein de l’institution scolaire.
Cela n’empêchera sans doute pas certains de confondre le maniement de la kalachnikov avec la virilité, mais on peut espérer contribuer ainsi à en dissuader beaucoup.
- Economie
- Europe
- ReSPUBLICA
Sur la dette grecque et son remboursement par le contribuable
par ReSPUBLICA
http://www.gaucherepublicaine.org
Reçu de Dominique Gérin le 9 février 2015 :
« Une restructuration forte [de la dette grecque] fera payer les contribuables des pays européens à commencer par l’Allemagne », écrivez-vous dans « Pourquoi la stratégie de Syriza est riche d’enseignements ».
C’est précisément le chiffon rouge qu’agitent devant nos yeux effarés les économistes à rond de serviette des TV mainstream. Or c’est faux. Ce que les contribuables des pays de l’UE ont versé pour “renflouer” la Grèce, ils l’ont versé à perte : c’est allé directement aux banques, qui se sont bien gardées de redistribuer quoi que ce soit ; en tout cas, pas au peuple. Et ce n’est pas vrai seulement pour la Grèce, c’est vrai pour tous les pays qui ont “bénéficié” de plans d’“aide” européens.
La restucturation d’une dette dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’elle ne sera jamais remboursée (quant au capital, c’est-à-dire quant au principal) ne vise qu’à étaler dans le temps le versement des intérêts.
Il faut donc cesser de faire peur au petit créancier avec de tels raccourcis. De toute façon, les petits créanciers (nos impôts) ne seront jamais remboursés. L’intérêt de l’UE serait d’accepter cette renégociation. Si l’UE tient à elle-même (c’est-à-dire à la fiction d’un Europe unie), c’est la moins mauvaise des solutions. L’autre, c’est, pour l’Allemagne au premier chef, de rester rigide, et de provoquer la sortie en catastrophe de la Grèce de l’euro. Dans les deux cas, il sera évident pour d’autres pays soumis au même chantage qu’on peut sortir de TINA (et de l’Euro et de l’UE). L’UE est prise en tenaille. (Et au vu de la bêtise du personnel politique de cette UE, il est à parier que c’est cette seconde solution qui prévaudra.)
Réponse de la Rédaction
Il serait donc faux, Madame, de dire que si la Grèce ne rembourse pas, les contribuables des pays créanciers paieront à sa place ? Oui, c’est faux, parce qu’il est vrai que nul contribuable français ne verra ses impôts augmentés de 650 euros pour renflouer la Grèce. Mais non, ce n’est pas faux, parce qu’il n’est pas vrai que cela ne coûtera rien, comme le prétendent certains journalistes1.
Cette apparente contradiction résulte de la confusion entre la France et les Français. La France est éternelle, au sens où quand elle prête ou emprunte, c’est l’ensemble des Français qui est concerné, la génération présente et les générations futures. Les dettes d’un Français meurent avec lui si ses descendants refusent de les hériter, celles de la France seront à la charge des générations futures, sauf épisode violent qui mettrait fin à la continuité de l’État.
Il est donc vrai qu’il peut sembler que, techniquement, la dette publique n’est jamais remboursée : quand vient une échéance, elle est remboursée à l’aide d’un nouvel emprunt. Mais il faut distinguer la dette à l’égard des marchés et la dette à l’égard des États.
À l’égard des marchés, il faudra à l’échéance trouver des prêteurs, sinon c’est la banqueroute. Si les « marchés » ne croient plus à la capacité des emprunteurs de servir la dette, c’est-à-dire de payer les intérêts et les tranches arrivant à échéance, ils vont exiger des taux d’intérêt de plus en plus élevés. Et les intérêts, il faut les payer. Or, quand le taux de l’intérêt devient supérieur au taux de croissance de l’économie, le pays doit pouvoir dégager un excédent primaire du budget (le solde avant paiement des intérêts), sinon le pays doit emprunter pour payer les intérêts et la dette fait boule de neige. C’est ce qui est arrivé en 2010 et a conduit les pays de la zone euro à se substituer aux banques créancières de la Grèce, pour éviter l’implosion de leurs systèmes financiers et le chaos total.
Certes, quand un État emprunte à d’autres États, ça lui coûte moins cher, dans la mesure où il s’agit de solidarité pour sauver l’euro, mais il perd sa souveraineté : dans le cas de la Grèce, avant Tsipras, c’était la Troïka qui gouvernait (après, on verra). Donc si la Grèce ne rembourse pas l’aide reçue directement des États en 2010, puis via le FESF (devenu MES) en 2012, la France devra s’asseoir sur les intérêts des 11 mds prêtés directement et emprunter pour les 31 mds de sa quote-part de garantie du prêt FESF. Il faudra donc trouver des prêteurs, ce qui n’est certes pas difficile, les banques sont noyées de liquidités qu’elles préfèrent prêter quasi-gratuitement aux États plutôt que prendre le risque de financer l’économie réelle.
Pour le moment, donc, les créanciers de la Grèce pourraient faire face à un défaut plus ou moins total, ils pourraient payer sans douleur pour les contribuables. Mais cette accumulation de dettes ne résout rien, elle ne permet que de gagner du temps, et à terme plus ou moins éloigné, les lois de l’économie présenteront la facture. Car le « choix » est entre, d’un côté, la continuation de la fuite dans la mise en œuvre de la « planche à billets », avec toutes les conséquences que l’on sait, de l’hyper-inflation type Italie pré-Mussolini ou Allemagne de Weimar à la montée des fascismes, et, de l’autre, l’austérité, qui n’a pour effet que de renforcer la persistance de la crise, ce qui conduira les « marchés » devenus frileux à rectifier leurs anticipations et demander des taux en hausse, qui feront exploser la dette des pays prêteurs.
Quelle que soit l’issue des négociation avec la Grèce, cela aura des conséquences pour le petit épargnant, à qui il ne s’agit pas ici de faire peur, mais de faire ouvrir les yeux. Le choix de la planche à billet et de l’inflation, auquel conduirait le plan grec, est celui de son euthanasie. Le choix de l’austérité, que privilégie l’UE, est celui de la continuation de l’austérité, soit plus d’impôts et moins de dépenses, qui implique la baisse du rendement de la petite épargne (on en voit notamment des prémices dans la fiscalité de l’épargne salariale). Il ne faut pas ignorer que les banques ont prêté à la Grèce pour alimenter les intérêts de la petite épargne (PEL, PEA, assurance-vie, etc.), et qu’en sauvant les banques, on a « sauvé » le petit épargnant.
Au total, quand un pays est en crise, ses ressortissants la paient toujours, d’une manière ou d’une autre, l’histoire en est témoin, que ce soit par le chômage, la misère, ou la guerre. Seuls ceux qui nient le fondement structurel de la crise du capitalisme et n’y voient que la conséquence de mauvais choix politiques dictés par l’intérêt ou la bêtise, peuvent croire que la solidarité avec le peuple grec peut faire l’économie de la critique du capital. L’Allemagne est prise entre deux feux, celui des avantages de l’euro et du marché unique et celui du coût de la solidarité européenne, et sa rigidité vient de ce qu’elle n’a aucune raison de payer2. L’internationalisme conséquent, c’est la solidarité des classes dominées contre les classes dominantes, pas celle des pays dominés contre le pays dominant.
Michel Zerbato
- Dans ce sens, on peut lire, par exemple :
• Ivan Best : http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20150203trib9d5c19803/une-annulation-de-la-dette-grecque-n-aurait-pas-d-effet-sur-les-impots-en-france.html)
• Franz Durupt : http://www.liberation.fr/economie/2015/02/13/l-annulation-de-la-dette-grecque-couterait-elle-si-cher-aux-francais_1201887.
En sens contraire, Jean Quatremer, un européiste plutôt enragé, mais plus conséquent que beaucoup d’autres sur ce point : ↩] - Cf « ↩]
- A lire, à voir ou à écouter
- Laïcité
Voir ou revoir : deux vidéos que nous avons aimées
par ReSPUBLICA
http://www.gaucherepublicaine.org
La casse du droit du travail : « toute dérégulation se traduit par un drame social… » (G. Filoche)

Le 29 janvier à « Là-bas si j’y suis » : Filoche démolit Macron
http://la-bas.org/la-bas-magazine/videos/filoche-demolit-macron
Les fondamentaux de la laïcité : « il n’y a pas de différences entre les cultures sinon de différences d’histoire » (H. Pena Ruiz) :
Colloque Liberté égalité laïcité & service publics de l’Académie des Banlieues, le 10 octobre 2014
- A lire, à voir ou à écouter
- Extrême-droite
Les Mystères du nazisme. Aux sources d’un fantasme contemporain, de Stéphane François
par Nicolas Pomiès
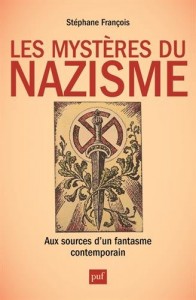 Ce livre propose une promenade dans le monde étrange, déconcertant parfois et toujours foisonnant, de nos contemporains qui croient en l’existence de la nature occulte du nazisme. Pourtant, il est indéniable que certains responsables du parti nazi furent des adeptes des théories ésotériques, comme l’ont mis en lumière certains travaux scientifiques d’universitaires anglo-saxons ou allemands, mais le sujet a jusqu’ici été délaissé par les universitaires. À l’exception notable de quelques grands historiens, ils ont fui le sujet, à juste raison d’ailleurs, car il est ouvertement piégé. De ce fait, l’étude des thèmes « occultistes » a été monopolisée par une foule de « chercheurs » indépendants, de farfelus, d’amateurs d’étrange et de fantastique, à commencer par Le Matin des magiciens de Berger et Pauwels, ou de militants politiques d’extrême-droite. Cette question des rapports entre l’occultisme et le nazisme est devenue au fil des ans un mythe agglutinant, agrégeant au fur et à mesure différents éléments. Elle est devenue tant un objet de fantasmes conspirationnistes qu’un vecteur pour une certaine idéologie néonazie.
Ce livre propose une promenade dans le monde étrange, déconcertant parfois et toujours foisonnant, de nos contemporains qui croient en l’existence de la nature occulte du nazisme. Pourtant, il est indéniable que certains responsables du parti nazi furent des adeptes des théories ésotériques, comme l’ont mis en lumière certains travaux scientifiques d’universitaires anglo-saxons ou allemands, mais le sujet a jusqu’ici été délaissé par les universitaires. À l’exception notable de quelques grands historiens, ils ont fui le sujet, à juste raison d’ailleurs, car il est ouvertement piégé. De ce fait, l’étude des thèmes « occultistes » a été monopolisée par une foule de « chercheurs » indépendants, de farfelus, d’amateurs d’étrange et de fantastique, à commencer par Le Matin des magiciens de Berger et Pauwels, ou de militants politiques d’extrême-droite. Cette question des rapports entre l’occultisme et le nazisme est devenue au fil des ans un mythe agglutinant, agrégeant au fur et à mesure différents éléments. Elle est devenue tant un objet de fantasmes conspirationnistes qu’un vecteur pour une certaine idéologie néonazie.
L’auteur propose au lecteur de faire le point des connaissances, d’analyser leur récupération à la fois par la droite radicale et par la culture populaire, et enfin de comprendre les raisons de la création d’un fantasme contemporain, sorte de catharsis cherchant à comprendre l’inacceptable et finalement à le banaliser puis l’accepter. Stéphane François historien des idées traque la source du mythe et du fatras ésotérique censé expliquer les origines du nazisme. Il est politologue lorsqu’il met en lumière les stratégies d’utilisation de ce mythe. Il conclue son livre sur le retour de la « nazimania » des années 2000 qui mêle l’occultisme aux mythes politiques des extrême-droites, phénomène en plein extension sur l’Internet. « Notre époque foncièrement anxiogène a besoin de nouvelles certitudes, et la croyance dans l’occultisme nazi en fait notamment partie. Elle revêt alors une fonction sécurisante vis-à-vis de la réalité et de l’évolution des sociétés occidentales, qui se manifeste au travers de trois points : un refus du « système » ; une élaboration alternative de l’histoire et du monde ; un hypercriticisme. »
L’ouvrage sort à quelques jours de la commémoration des soixante-dix ans de la libération d’Auschwitz. Ce camp d’extermination représente finalement le paroxysme du délire nazi dont les sources bien réelles que Stéphane François rappelle en conclusion n’ont « rien de magique ou d’occulte ». Or le passage dans la culture populaire (littérature fantasmagorique, bande-dessinée fantastique, cinéma ou pornographie « naziploitation » etc.) d’une culture marginale bâtie sur des « bricolages » selon l’explication de Claude Lévi-Strauss peut être utilisée de manière stratégique comme moyen de subversion. Il est donc légitime, à l’heure où les témoignages des rescapés de l’horreur se font de plus en plus rares et que, comme le rappelait ReSPUBLICA, les conditions sont réunies pour que le spectre des années 30 hante de nouveau les pays européens, de s’inquiéter de cette subversion rendue possible par une relative banalisation culturelle du nazisme.
D’où l’intérêt du travail de décorticage de Stéphane François pour expulser toutes les scories de la nazimania de la culture de masse et gagner les batailles culturelles nécessaires pour réenchanter le monde.
Les Mystères du nazisme. Aux sources d’un fantasme contemporain, Presses Universitaires de France, 2015, 200 p., 19 euros.



 Bien que le journal électronique soit rédigé par des contributeurs non rémunérés, nous devons faire face à des frais (notamment informatique). C'est pour cela que votre aide financière est la bienvenue pour nous permettre de continuer à vous informer sur les combats de la Gauche Républicaine et Laïque. Pour ce faire vous pouvez faire une adhésion de soutien en vous inspirant du barème ci-après et en nous envoyant sur papier libre vos Noms, Prénoms, Adresse et courriel à :
Bien que le journal électronique soit rédigé par des contributeurs non rémunérés, nous devons faire face à des frais (notamment informatique). C'est pour cela que votre aide financière est la bienvenue pour nous permettre de continuer à vous informer sur les combats de la Gauche Républicaine et Laïque. Pour ce faire vous pouvez faire une adhésion de soutien en vous inspirant du barème ci-après et en nous envoyant sur papier libre vos Noms, Prénoms, Adresse et courriel à :